Des bulles d'air figées dans leur mouvement par la matière qui les a emprisonnées en cristallisant instantanément.
Phénomène observable avec une simple loupe 10x.
Photo Gem' Expertise ©
Le spinelle synthétique Verneuil
15 février 2013Bref historique de la synthèse Verneuil
Cet article s'adresse à chaque personne concernée par le milieu des pierres précieuses. Le spinelle synthétique Verneuil se trouve en très grande abondance sur le marché.
Nous
allons nous consacrer aux spécificités de ce cristal gemme reproduit en
laboratoire pour savoir comment le reconnaître rapidement, dans sa
synthèse la plus courante, celle qui porte le nom de son inventeur :
VERNEUIL.
Dès les premières décennies du XXème
siècle, avant même d'être véritablement connu comme pierre naturelle de
grande beauté pouvant être extraite des entrailles de la Terre, le
spinelle a été synthétisé en laboratoire. Dans le mode de synthèse qui
nous intéresse, il s'agit d'une découverte "accidentelle" durant des
travaux de recherches sur la synthèse (synthèse dite par fusion sèche ou
fusion dans la flamme) des saphirs et rubis ardemment menés à
l'époque. Certaines sources rapportent qu'il y a eu une erreur de
manipulation dans les composants de base.
Pour
comprendre les conditions de cette découverte fortuite, il faut
préciser que le spinelle est un oxyde de magnésium et d'aluminium [Mg Al2O4],
c'est-à-dire que si l'on pouvait l'exprimer ainsi, son "ADN" est
composé d'atomes d'oxygène, d'aluminium et de magnésium. Le corindon
(qui regroupe le saphir et le rubis) est différent car c'est un oxyde
d'aluminium Al2O3.
Son "ADN" à lui n'est donc composé que d'atomes d'oxygène et
d'aluminium… Sans magnésium, contrairement au spinelle. Cette "simple"
différence dans la composition chimique de ces deux variétés de pierres
précieuses conduit pourtant à une énorme différence de propriétés des
matériaux gemmes que le gemmologue s'empressera d'exploiter.
Un
deuxième facteur s'ajoute pourtant, et c'est lui le plus important. A
l'état de pureté "absolue", ni le spinelle, ni le corindon ne possèdent
de couleur. Ils restent, si leur composition respecte la formule
chimique évoquée précédemment, totalement incolores.
Comment
la couleur peut-elle alors s'y trouver ? C'est grâce à la présence
d'autres éléments (d'autres atomes qui sont considérés alors comme
impuretés -nommés éléments chromogènes- qui ne font pas partie des
éléments de la formule du cristal parfait) qui vont venir se substituer
aux atomes d'aluminium dans la composition des cristaux, lors de leur
croissance, du fait de leur présence exogène. Le cristal de spinel est
par conséquent un matériau dit allochromatique (les éléments provoquant
la couleur sont extérieurs à sa composition de base, à sa formule
chimique parfaite).
Par
exemple, quand le chrome colore le corindon en rouge, on parle de rubis
car, le corindon incolore, pur dans l'absolu, est devenu rouge par une
présence infinitésimale d'atomes de chrome. Pour le spinelle, c'est
aussi le chrome qui colore la pierre en rouge. Au final, la présence de
ces atomes piégés (ou de substitution) lors de la genèse du cristal
offriront la couleur et la beauté recherchées.
Dans
le cas du spinelle synthétique Verneuil, il aura donc fallu que du
magnésium soit inopinément interverti ou confondu avec celui d'un
élément colorant destiné à colorer du corindon pour que quelque temps
plus tard, Auguste Victor Louis Verneuil (1856-1913) chimiste
dunkerquois et inventeur de cette synthèse prometteuse donne son nom à
la gemme de cette étude : le spinelle synthétique Verneuil.
Zoom sur des bulles d'air figées lors de la cristallisation de la matière.
Investigations à la loupe 10 x
La compréhension du principe de fabrication de cette synthèse rend plus aisée la recherche des inclusions dans le matériau synthétique obtenu.
De
nombreux sites détaillent cette synthèse sur Internet. On prend les
composants de départ à l'état de poudre (état solide - aluminate de
magnésium [Mg Al2O4],
dans le cas du spinelle incolore) que l'on fait fondre au contact d'une
flamme (il faut plus de 2000° C). La poudre passe donc à l'état de
liquide (elle a fondu), et "tombe" par simple gravitation sur un germe
situé plus bas que la flamme. Puis la matière première change à nouveau
de contexte thermique et donc d'état (il fait plus froid en quittant la
flamme) et se solidifie en un temps record mais cette fois-ci dans un
monocristal sur une amorce que l'on met en rotation (un peu comme une
flaque se figerait en glace une fois la température nécessaire
atteinte).
L'aluminate
de magnésium, en continuant d'être saupoudré régulièrement va faire
grossir le germe cristallin par couches concentriques. Certaines bulles d'air (inclusions
gazeuses) présentes à différents stades du processus vont venir
s'enchâsser dans la matière cristallisée. C'est elles que l'on doit
rechercher à l'observation. Elles peuvent avoir différentes formes, mais surtout celle dite "télescopée".

Très
fréquememnt incolore, bleu ou rose, le vert se rencontre aussi.
Beaucoup de ces spinelles synthétiques, une fois taillés, sont purs à la
loupe 10x.
Une singularité dans sa composition
A noter que le spinelle synthétique Verneuil fait un peu exception aux
règles de nomenclature. Il est en effet toléré de traiter ici de
spinelle synthétique même si le procédé ne reproduit pas rigoureusement
à 100 % la même composition chimique que le spinelle naturel. L'analyse
chimique de cristaux révèle que les proportions des quantités d'atomes
dans la formule chimique naturelle du cristal [Mg Al2O4] ne sont plus les mêmes dans les Verneuil : le rapport de la quantité d'aluminium dans un Verneuil
par rapport à celle du magnésium y est plus forte. Il s'agit d'une
singularité propre au spinelle dans ce mode de fabrication. C'est un
atout énorme pour le gemmologue qui va pouvoir "lire" ce changement de
composition avec un simple polariscope!
Le
spinelle a le même caractère optique que le diamant, c'est à dire qu'il
est isotrope (iso = même et trope = comportement). Ainsi, un rayon
lumineux qui traverse un cristal de spinelle est simplement réfracté (et
monoréfringent - dévié et ralenti de son parcours initial).
Mais
comme indiqué précédemment, le spinelle synthétique Verneuil comporte
des différences de dosages dans le rapport Aluminium et Magnésium. Ceci
génère dans la structure du cristal des tensions dont les causes
endogènes vont s'identifier lors du passage de la lumière dans le
cristal. L'utilisation du polariscope (filtres croisés #) illustre cela
très distinctement, et on parlera d'anomalies de polarisation.Un comportement bien spécifique AU POLARISCOPE EN FILTRES CROISES

Recherche
des anomalies singulières au polariscope en filtres croisés. Attention,
il ne s'agit pas comme pour le verre de lignes vermiculées au contour
bien défini.
Le
polariscope est, avec la loupe, un outil de base indispensable en
gemmologie. En plaçant un spinelle sur la table de celui-ci, en veillant
à croiser les filtres (le fond doit donc être noir), il est possible,
tout en prenant bien soin de faire tourner la pierre posée à l'étude, d'y détecter des figures d'apparence filandreuses
(nommées parfois lignes tigrées ou tatamis) qui semblent littéralement
se mouvoir en traversant la pierre. Ces lignes peuvent évoquer des
nuages noirs visionnés en vitesse accélérée, qui se déplacent très
rapidement, toujours dans la même direction, à l'infini, du moins, tant
que l'on fait tourner la pierre. Il
s'agit de figures d'extinction anormales plutôt remarquables dues à des
tensions internes dans le cristal, elle même générées par le
"non-respect" des proportions des éléments constitutifs du cristal de
synthèse par rapport au cristal naturel*.
L'idéal
étant de pouvoir combiner la lecture au polariscope (et dans ce cas, il
faudra un polariscope de table) avec la loupe 10 x pour les observer au
cœur de plus petites pierre. Cette figure d'extinction est vraiment
très particulière. Combinée à quelques autres éléments (présence de
bulles téléscopées, couleur parfois singulière et IR), on obtient le
diagnostique recherché. Enfin, et pour rappel, la présence des bulles
(télescopées ou irrégulières et déchiquetées, parfois en forme de toiles
d'araignée hexagonale) est beaucoup plus facile à détecter dans ce
cadre d'observation (POL # et loupe 10x) et leur relief est
particulièrement mis en valeur.
Ces lignes représentent les tensions présentes dans la matière, au cœur du cristal.

Pour aller plus loin
Le
changement de proportions par rapport au référent naturel engendre une
densité modifiée aussi; elle est plus importante (3,61 à 3,67). L'indice
de réfraction est également concerné: on obtient des valeurs situées
entre 1,725 et 1,730 et plus généralement 1,728.
Sont exploitables encore d'autres outils : les lampes à UV et le filtre de Chelsea qui donnent de bons éléments de convergence.
Grâce
à ce procédé de fabrication Verneuil, ont été produites des myriades
industrielles de corindons synthétiques (rubis, saphir, saphir de
différentes couleurs et étoilés) en plus des spinelles synthétiques de
différentes couleurs. Les délais de productions très courts et le prix
de revient des matériaux obtenus (tous de la famille des oxydes) ont
permis d'atteindre des courbes de productions particulièrement
révélatrices.
Comme
il est très courant de trouver des synthèses Verneuil sur le marché, il
est essentiel de rester très vigilant. Internet se révèle être un
nouveau vivier de pierres synthétiques ou d'imitation frauduleusement
annoncées comme étant naturelles.
Les
beaux spinelles naturels sont très rares ! Issus des plus beaux
gisements ils trouveront aisément une âme à séduire. Leur histoire
personnelle évoquée dans "Gemmes de beauté, gemmes oubliées" nous prouve qu'ils atteignent allègrement les places d'exception auxquelles ils sont réellement destinés.
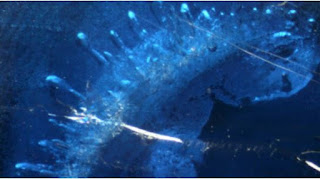

Commentaires
Enregistrer un commentaire